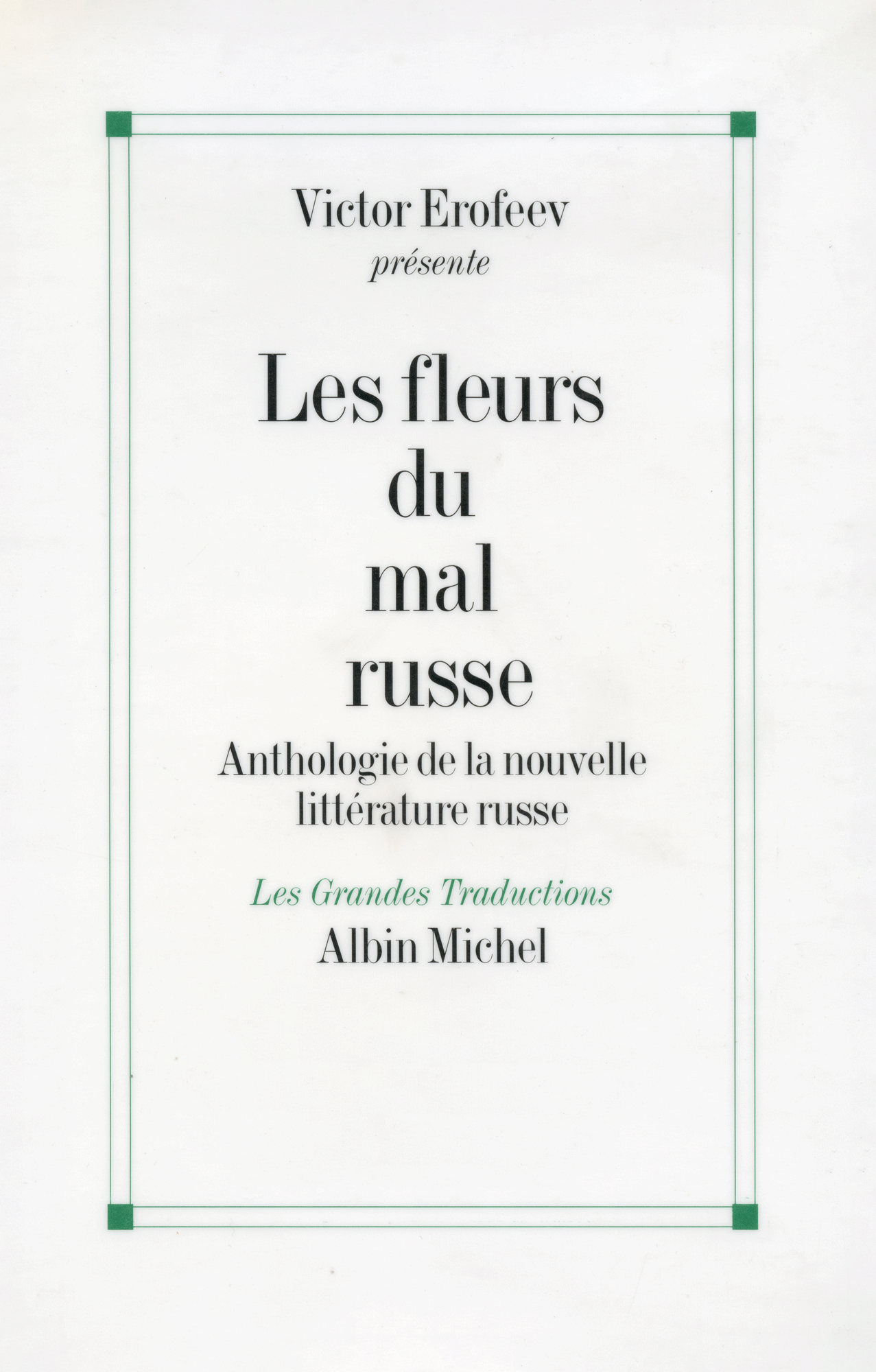The Night Supper
Edouard Limonov
Je suis un homme seul et mes divertissements sont ceux d'un solitaire. Même lorsque je vis avec plusieurs femmes, je suis et je reste un solitaire.
*
Lorsque j'arrivai à New York, dix ans après mon premier atterrissage dans cette ville, je descendis au même hôtel, le Latum, où j'avais passé ma première nuit sur le continent américain, celle du 18 au 19 février 1975. J'arpentai ses couloirs en me plongeant dans mes souvenirs avec une gourmandise somnambulique. Je n'appelai pas mes vieux amis. Mon cœur débordait de tendresse pour eux mais je n'avais aucune envie de les voir. J'aime que les personnages de ma vie passée restent tranquillement à leur place au lieu de venir se prendre entre mes jambes en surgissant inopinément dans mon présent.
Me retrouvant dans la ville de ma seconde jeunesse, je repris, sans même m'en rendre compte, mes habitudes d'alors, et mon emploi du temps lui-même redevint aussi décousu, improvisé et chaotique qu'à cette époque. Je m'éveillais brusquement à deux heures du matin, m'habillais et descendais dans New York pour errer dans les rues jusqu'à l'aube. Aux aurores j'achetais au supermarché un carton de bières, un morceau de saucisson polonais tordu en U et je rentrais à l'hôtel. J'allumais la télé, m'allongeais sur mon lit, buvais mes six boîtes de bière et mangeais mon saucisson. Ce saucisson prétendu cuit était fabriqué, je présume, à base de pures hormones. En tout cas, lorsqu'on y enfonçait ses dents, on découvrait qu'il était d'un rose vénéneux. Sur l'écran de la vieille télé c'étaient les mêmes roses et verts vénéneux.
Allongé dans ma chambre du Latum avec la bière, la télé et le saucisson polonais, j'eus le plaisir de découvrir que j'étais parfaitement heureux. Les stupid shows qui me plaisaient naguère se poursuivaient toujours ou se répétaient et, au bout de quelque temps, j'avais appris sans peine à reconnaître qui était qui dans ces nouvelles séries. Le fait que ces shows fussent stupides ne m'empêchait pas d'avoir des idées sérieuses et profondes à leur propos. En voyant les bouilles bien nourries des héros, je me disais sans méchanceté que les « Amerloques » faisaient penser à des extraterrestres, qu'ils avaient moins de rides que les Européens, que si la face d'un Européen c'est un morceau de viande coriace composé des parties bouffies sous les yeux, des joues creuses, des plis autour de la bouche et des oreilles, la bouille américaine représentait, elle, un morceau de viande plus lisse, plus « généralisé ». Un morceau que l'histoire n'avait pas travaillé, que la culture n'avait pas marqué de ses ornements raffinés, bref un moulage tout nu, éhonté. Je me rappelai le film « Body Smasher » — ces ravisseurs de corps venus du cosmos qui sont des clones humains mais pas des humains. A les regarder de plus près, on s'apercevra sans peine que les acteurs de « Dynasty » ou de « Dallas » (si je les nomme ici, ce n'est pas pour les juger avec mépris en intellectuel snob mais pour la bonne raison que ces séries sont connues du monde entier et que chacun pourra juger à sa guise) ont des visages inhumainement lisses, que leurs cheveux sont sans défaut, comme les perruques artificielles ou les poils des chiens châtrés bien nourris. Les Américains ressemblent aussi à des malades mentaux traités à l'insuline. (Il y a longtemps, dans l'asile d'aliénés de Kharkov, j'étais entouré par ces homoncules tranquilles, les « insulinés ».) Nos brothers américains ont l'air d'humains mais, qui sait, si on leur ouvrait un bras ou une jambe (comme dans le film « Exterminator » où le robot Schwarzenegger se « répare » le bras), peut-être découvrirait-on un squelette mécanique ou des cartes électroniques comme dans un ordinateur. Fort heureusement, les habitants réels des villes et des cités américaines sont moins lisses que les Américains télévisés.
*
Il avait fait chaud tout ce fameux jour. Mais le soir l'air devint plus frais, et encore plus frais après la tombée de la nuit. Le vent avait soufflé les nuages chauds hors du ciel de New York, une grosse lune était apparue et la nature avait pris un air automnal. Cette fraîcheur n'était pas de saison, d'ordinaire le début de septembre à New York est humidement lourd, aussi me sentais-je tout drôle. Aux environs de minuit, je me retrouvai sur Broadway, dans un bar du middletown. Une chanteuse de jazz chantait derrière son piano.
Je bus dans la pénombre plusieurs Guinness l'une après l'autre et j'essayai de causer avec la chanteuse. La chanteuse me méprisa. Cet événement ne jouera pas le rôle du fusil de Tchékhov et ne tirera pas au dernier acte de la pièce, cependant c'est lui qui donna le ton à cette soirée et à la nuit. Me sentant symboliquement rejeté non seulement par la chanteuse mais par tout New York, je m'enflammai du désir d'être de nouveau accepté dans le giron de ma ville chérie et ce désir m'amena vous verrez où. La raison du refus fut formulée par la chanteuse sous une forme si directe que je me permettrai de citer ici notre bref entretien. A ma question de savoir si elle aurait bientôt fini de chanter et si je pourrais alors lui proposer un verre dans un autre bar, la grande fille tira de son sac ses lunettes cerclées de rouge (c'était pendant la pause de l'entracte), les mit sur son nez et me répondit avec le plus grand sérieux, sans sourire : « Sorry, non. J'ai assez d'hommes dans ma vie. Un boy-friend permanent et trois autres de temps en temps. Si tu étais du show-biz, tu m'aiderais à me tirer de ce sale trou », fit-elle en écrasant du talon les copeaux qui jonchaient le sol, « mais tu n'es même pas américain. Je suis sûre que tu es un bon mâle mais je suis fatiguée des mâles. » Elle enleva ses lunettes et les cacha dans son sac. Je lui dis que je voulais simplement l'inviter à boire un verre parce que j'avais aimé sa façon d'interpréter, elle, une Blanche, le répertoire de Billie Holiday. « C'est ça, tout répertoire se termine au lit », fit-elle d'un air las. Quelqu'un avait dû lui faire de très vilaines choses au lit, me dis-je, pour qu'elle soit devenue l'ennemie jurée de tous les lits.
Je sortis du bar et, sans penser à rien, remontai Broadway. Le fait est qu'en 1977 j'avais habité là-bas, un peu plus haut. Mes jambes me portèrent malgré moi jusqu'à l'hôtel Embassy. J'y avais déjà fait un tour pendant ce dernier séjour. Je savais que les Japonais qui avaient racheté l'édifice avaient transformé cet hôtel puant, merveilleusement décrépit et peuplé par quelques centaines de miséreux (tous des Noirs sauf Limonov), en un ensemble d'appartements onéreux et stupides, l'Embassy Tower… Arrivé à hauteur de la 72e rue, j'hésitai à son angle est… Je me dis que remonter plus haut sur Broadway n'avait aucun sens, que j'avais un besoin pressant pour le moins de bière, et peut-être même d'une demi-boucle de saucisson polonais. A vrai dire, mes moyens m'interdisaient de prendre une Guinness dans un piano-bar, sans parler des trois… Si j'achetais du saucisson et une bière, cela n'équilibrerait pas mes dépenses mais arrêterait au moins le processus fatal du gaspillage. Je peux redescendre Broadway de quelques rues et là-bas, me dis-je, près de l'Ansonia Post Office, il y a un supermarché « I and P » ouvert toute la nuit. Il se peut d'ailleurs qu'il n'existe plus.
Le supermarché était à sa place, miroitant gaiement de ses vitres pare-balles opaques. C'est ému que j'entrai dans ce vieil ami. Une bouffée de sales odeurs familières me frappa au visage… J'y avais acheté un nombre incalculable de fois mon « menu » de nuit : saucisson, bière, vilain hamburger bon marché, pain aux allures de coton hydrophile… Le même gros gardien mexicain avec sa matraque (c'est lui ou pas lui ? c'est lui) bavardait avec la caissière noire, le même manager (gris-vert de peau) allait et venait en alignant les caddies, le même ventre bas bombant sous le même pantalon. Les mêmes biftecks hachés rouge vif embués sous leur film de plastique se proposaient pour des hamburgers. Surabondance de mauvaise nourriture bon marché, mal empaquetée… Le paradis des pauvres. Des poulets transformés en blocs de glace, de l'eau sale gouttant sur le carrelage de dessous la vitrine de viande, ô supermarché de ma jeunesse new-yorkaise, on ne t'a pas transformé comme l'Embassy, tu es resté la boîte sale et malsaine que tu as toujours été. Souvent mes voisins de l'Embassy, érémistes alcooliques, se faufilaient d'un pied peu sûr à cette heure de la nuit au milieu de tes trésors à bas prix pour y choisir une malt liquor à l'étiquette d'un bleu toxique. Une population mieux nantie a débarqué aujourd'hui sur les rives de Broadway du côté d'Ansonia Post Office Station, on voit moins de visages noirs… Bientôt le supermarché sera transformé en un lieu aseptisé, les prix augmenteront…
Je ne trouvai pas de saucisson et me procurai une boîte de porc en conserve et un sac en plastique avec des brioches. Ils vendaient maintenant des boissons fortes ! Dans un petit réduit protégé par des vitres pare-balles, on aurait dit. De mon temps on ne proposait au consommateur que de la bière et du malt. Je me demandai au passage pourquoi ces vitres pare-balles (les gars de Harlem prendraient-ils d'assaut les bouteilles d'alcool de ce supermarché ouvert la nuit ? peu probable…), achetai une bouteille de porto et, après avoir rangé étourdiment mes achats dans un brown bag, je quittai le supermarché.
*
La nuit était devenue encore plus nocturne. Je pensai aux quarante blocs me séparant de l'hôtel Latum, repoussai résolument l'idée de prendre le métro comme peu attrayante, caressai de la main la bouteille de porto au fond du sac, serrai entre mes doigts le plastique avec les brioches et décidai de m'offrir un souper de nuit en pleine nature. Un pique-nique. Où ça ? Il suffisait de ne pas avoir la flemme et de se diriger vers Central Park. On pouvait s'y installer dans l'herbe et s'offrir un souper poétique au clair de lune new-yorkais. Allez, souviens-toi de ta jeunesse, fais comme au bon vieux temps…
Je me permettrai ici une digression pour parler de mes relations avec Central Park. Certes, les New-Yorkais ont peur du parc et ne s'y aventurent jamais la nuit. (Si l'homme blanc ne s'aventure jamais, même de jour, dans sa partie nord, celle qui côtoie Harlem, que dire de la nuit…) Mais je suis un type à part. Je connais la peur, comme tout un chacun, mais j'adore la défier. Je m'escrime toujours à prouver mon courage aux autres et à moi-même. La première fois que je traversai Central Park la nuit, ce n'était pas poussé par le courage mais par une extrême fatigue. J'avais beaucoup bu chez mon copain Bakhtchanian dans la 83e est et comme je n'avais pas les moyens de prendre le bus ou le métro, je me dis pourquoi pas. D'habitude je rentrais chez moi de chez ce copain, que j'allais souvent voir, en contournant Central Park : je descendais l'East Side jusqu'à la 59e qui s'appelle aussi la Central Park South, je la suivais jusqu'à la West et je remontais la West jusqu'à l'Embassy. Je franchis donc le mur de pierres du parc (on pouvait passer par une des issues toujours ouvertes mais je préférais faire le mur comme il sied à un vrai bandit pour le cas où quelqu'un me verrait) et je me dirigeai vers l'ouest, obstinément, d'un arbre à l'autre, d'un buisson à l'autre, à découvert et avec bruit. C'est ainsi qu'avancent les bandits, les aborigènes, les maîtres de ce territoire. Je me persuadais moi-même : « Édouard, c'est toi le méchant, la terrible silhouette nocturne qui se promène la nuit avec insouciance sur leur territoire. C'est toi l'être le plus terrifiant de la nuit, tes buts sont mystérieux et imprévisibles. On doit avoir peur de toi… » Un cycliste attardé, peut-être sous l'effet de mes incantations, s'écarta, effrayé, du bord de la route et, prenant la file de plusieurs taxis qui traversaient le parc d'est en ouest, appuya sur les pédales. Peut-être étais-je réellement à craindre en 1977 ? J'étais alors en pleine crise. Je n'avais rien à perdre parce que je n'avais encore rien trouvé… Je m'enhardis et traversai Central Park chaque fois que l'occasion me conduisait de ou vers l'Upper East Side. A chaque fois j'éprouvais une certaine appréhension mais ce frisson de vingt à vingt-cinq minutes devint pour moi une nécessité…
C'est en pensant à mes exploits de jadis et en souriant à mon insouciance d'alors que j'arrivai au parc à hauteur de la 70e rue. Un brown bag à la main, jean blanc, bottes, veste claire. Sans me retourner, sans choisir le moment opportun, j'avançai vers un banc, mis le pied sur le siège puis sur le dossier et, de là, sur le mur de Central Park. Et je sautai résolument. Le mur, relativement bas du côté de la rue, s'enfonçait de deux bons mètres du côté du parc. La terre se révéla plus basse que je ne l'avais escompté. Fort heureusement, la couche d'herbe qui me reçut était aussi grasse que le ventre de l'Américain moyen.
Ciel, qu'on était bien. Le clair de lune. L'odeur âpre — malgré les émanations d'un mélange d'essence et de poussière — des plantes prises par un début de putréfaction. Les arbres dansant leur bal masqué, chaque ombre profonde et impénétrable. Je marchais dans le froufrou de l'herbe…
Mais je décidai de ne pas trop m'enfoncer et restai sur un territoire que je connaissais. Du côté de la 72e rue (c'est là qu'au coin de la Central Park West s'élève la forteresse de l'immeuble Dakota où habitait John Lennon, et c'est devant le Dakota qu'il s'est fait descendre), on entendait des tambours. De mon temps, devant l'entrée vivement éclairée du parc, du côté de la 72e rue, se rassemblaient les maîtres avec leurs chiens et les athlètes du quartier. Ils échangeaient des plaisanteries ou s'engueulaient. Nous autres, habitants de l'Embassy, nous venions aussi sur ce carré. Nos hommes venaient avec leurs tambours et offraient de la musique africaine à la nuit. Qui jouait du tambour maintenant ? Étaient-ce « les nôtres » venus de la 150e rue où ils avaient été transférés ? Je sentis que j'avais besoin de ces tam-tams familiers, de cet accompagnement pour mon souper nocturne. «Aurais-tu peur, Edouard, m'interrogeai-je en avançant sous un pin aux branches extraordinairement larges. Tu fais maintenant partie de la haute et tu crains les divertissements de ton ancienne classe sociale, tu te tiens le plus près possible de la sortie ? »
Le tronc du pin se dressait sur la pente d'une petite butte tandis qu'une partie de sa couronne aux branches puissantes et qui constituait comme un autre arbre était penchée jusqu'au sol et se couchait sur l'herbe en me protégeant par-devant… mettons du regard des curieux. Humant l'air résineux, je lâchai mon brown bag dans l'herbe. Désirant mieux m'imprégner du parfum, je cueillis une branche en me piquant, en frottai les aiguilles entre mes doigts et en aspirai la senteur. Que c'était bon. Je me sentis comme un estivant dans sa maison de campagne et j'éclatai de rire.
Après la première gorgée de porto, je me sentis encore mieux…
Pour ouvrir la boîte de conserve, ce fut toute une histoire. Je tirai trop fort sur l'anneau et seul un morceau de la peau métallique se détacha, n'ouvrant qu'une étroite fente pour parvenir au contenu. Je dus débarrasser une branche de ses aiguilles et attraper les morceaux poisseux de porc avec. Le porc se révéla douceâtre. Mais, n'étant pas un gourmet, je n'ai jamais manqué d'appétit…
Fatigué par l'effort que nécessitaient le piochage de la viande, la division des brioches et la mastication, je posai la boîte de conserve sur le brown bag, avalai une série de gorgées de porto et m'adossai au tronc. On entendait au loin mugir faiblement les voitures, la distance rendait même les sirènes de police moins agaçantes, une paix et un calme campagnards régnaient sur la collectivité des plantes échevelées. A travers les aiguilles du pin, des gouttes de lumière lunaire tombaient sur mon brown bag, ma boîte de conserve mutilée et mes brioches. Lorsque le vent écartait la frondaison, elles jaillissaient sur l'herbe…
Je fus tout naturellement envahi par les souvenirs. A chaque fois que je m'installe confortablement, ils m'envahissent et viennent usurper le présent. Ils se posèrent sur moi comme des nuages roses mais invisibles, comme une radiation. J'allai en pensée jusqu'aux tambours et de là suivis la Central Park West jusqu'à la 71e rue. J'y avais travaillé quelques jours avec le vieux Lenia Kossogor à installer un appareil de radiographie au docteur… le temps avait dévoré son nom. Après l'avoir posé, nous entreprîmes de tapisser de plomb les parois de la cellule radiographique… A quoi pouvait me servir ce souvenir ?… Il se trouva qu'emportée par les métaux la mémoire cherchait les feuilles de plomb. Les lourdes feuilles de plomb surgirent du fond des années avec leur structure, leurs éraflures… La grande massue de bois ronde venait frapper régulièrement la feuille noire, l'écrasant contre la surface du mur… Ma mémoire se posa ensuite sur Lenia Kossogor. Le grand Kossogor au dos voûté boutonne son pardessus ouatiné de Moscou ; nous suivons la 71e rue, nous dirigeant vers Broadway, vers le MacDo… L'intérieur du MacDo sur Broadway : Kossogor en manches de chemise mange des frites avec ses mains en me traitant tendrement de « connard »… Kossogor veillait sur moi comme le père qu'il pouvait être, vu son âge… Où est-il à présent, Lenia Kossogor ? Je revis la tanière de Kossogor dans le soubassement de l'Astoria, ses outils… Je devrais l'appeler, c'est un brave mec… Je bus une gorgée de porto… Au moment où j'équilibrais la bouteille dans l'herbe, je vis, cachée par les branches, la silhouette d'un homme qui me dissimulait la lumière de la lune…
La terreur n'est pas l'ultime degré de la peur, c'en est une qualité particulière. Il est impossible d'éprouver de la terreur dans un café de la place de la République à Paris lorsque, progressivement échauffé par une dispute, votre adversaire sort un couteau et vous en menace. Normalement on éprouve un sentiment de peur. Le mec au couteau peut être un vrai dur et finir réellement par vous éventrer. Il peut aussi rentrer son couteau. Mais vous êtes entouré par d'autres humains, le patron peut venir s'en mêler, vous ne croyez pas trop qu'il ira jusqu'à utiliser son arme, et puis vous réussirez peut-être à lui envoyer votre verre dans la gueule, à lui balancer une chaise dans les jambes. Vous ne voulez pas perdre votre dignité d'homme, vous lui gueulez dessus, il vous injurie… Même si vous avez peur, vous n'éprouvez aucune terreur… Ou encore : c'est la guerre, vous êtes à plat ventre à côté d'un autre soldat dans l'attente du signal de l'attaque ; vous tenez dans vos mains une mitraillette et sa dureté vous donne du courage. Même si, une seconde plus tard, une bombe venait à décimer tout votre régiment, vous n'auriez pas le temps d'avoir peur… Troisième situation : vous êtes fait prisonnier par une bande, on vous a enfermé dans une cave et enchaîné à un anneau de fer ; vous éprouvez de la peur (il arrive parfois, quoique rarement, qu'on tue les otages), vous éprouvez des incommodités physiques, de l'humiliation… Mais vos ravisseurs masqués vous apportent à manger, vous pouvez même leur parler. Dans les conditions où tout ou presque est clair, la terreur ne peut survenir. Pour éprouver de la terreur, les conditions suivantes sont nécessaires :
1. Une ignorance presque absolue du caractère du danger.
2. Des circonstances rendant impossible l'obtention de toute information concernant le danger.
3. Une « dimension mystique » — la conduite alogique et imprévisible du Danger (de la Bête, du Dragon, du Monstre de Frankenstein, de l'Esprit Malade…) qui poursuit un but non humain…
J'éprouvais précisément de la Terreur. Lui (le Danger), il se tenait silencieux, vêtu d'un pantalon clair et d'une chemise blanche… un couteau à la main. (Pourquoi cette lame nue dans la main, quel est son but ?) Ce grand couteau, pareil à un accessoire de théâtre, expressif à outrance comme la faux de la Mort sur les vieilles gravures, tantôt scintillait sous un rayon de lune ou d'étoile ou d'un lointain réverbère, tantôt ternissait jusqu'à disparaître. Il tenait son couteau dans sa main gauche près de sa hanche et de l'autre écartait une branche. Ayant écarté la branche, il me regardait.
C'était peut-être un homme d'affaires, un plaisantin sorti la nuit d'un des prestigieux buildings de la Central Park West à la recherche de dangereuses aventures (ce qui était peu probable), mais cela n'y changeait rien… Je restais pétrifié comme un paralytique, ma bouteille de porto à peine sortie de ma bouche, à hauteur de ma poitrine…
Il se taisait et retenait la branche… Et ce couteau… C'était un Blanc, et même vraisemblablement un blond. Peut-être d'ailleurs sa blondeur provenait-elle de la lueur verdâtre répandue par les herbes et les arbres. Je ne pouvais distinguer les traits de son visage car la lune était derrière lui. De taille moyenne, assez fort ou c'était l'impression que donnaient sa large chemise et son pantalon… Tel un lièvre pétrifié devant la gueule ouverte d'un boa, je l'observais, comme hypnotisé. Pour l'unique raison que je ne voyais pas ses yeux, je trouvai en moi la force de dire à haute voix : « Would you like to hâve a drink avec moi ? » Et je tendis vers lui ma bouteille à bout de bras. Aussitôt je me rendis compte que c'était une bêtise que de lui donner ma bouteille, seule arme que je possédais contre son grand couteau.
Il lâcha la branche, fit demi-tour et s'éloigna dans les profondeurs du parc, en faisant doucement bruisser l'herbe. Il ne voulait pas d'alcool, il ne m'avait pas demandé money, il était de l'espèce supérieure et terrible entre toutes — un idéaliste lunaire. Les mecs qui ne veulent pas votre argent et qui ne veulent pas vous violer désirent probablement vous dévorer… Sinon, pourquoi ce couteau ? Et quel couteau ! Vous égorger et vous manger. De la même façon que je venais de manger mon porc à la gelée. Sous ce même pin. Je me sentis un lapin dans sa cage que son maître, après l'avoir observé, n'aurait pas choisi pour son dîner… Tout en suivant des yeux la silhouette qui s'éloignait, je portai la bouteille à mes lèvres et suçai le plus que je pus de liquide doux et fort. J'essayai de comprendre si je m'étais jamais trouvé dans ma vie dans un état semblable. Je dus m'enfoncer jusqu'à l'âge de neuf ans, l'âge de ma conscience précoce. Par un gros orage tonitruant, j'avais su soudain que mes parents mourraient un jour et que je resterais seul. Le destin de l'homme s'ouvrit à moi, un enfant, lors de cet orage. J'éclatai en sanglots, je m'en souviens, ma tête cachée dans le sombre placard du couloir, dans l'appartement ; c'est là que l'on gardait les vieilles couvertures et toutes sortes de vieilleries inutiles. Le tonnerre ébranlait le ciel de la banlieue de Kharkov. Ma mère était venue de la cuisine pour me consoler. Pourquoi la terreur m'avait-elle visité durant cet orage ? Cependant la terreur d'alors était bien différente : c'était la terreur devant la destinée humaine. La terreur de la mort future, la terreur de l'idée de la mort…
Une bouffée d'air amena une odeur de fumée de la 72e rue. Avaient-ils fait un feu là-bas, ou quoi ? La même bouffée rapprocha de moi les tambours. Je soulevai la boîte de conserve et plongeai mes doigts dans la gelée de porc. La gelée poisseuse fît glisser le morceau. Si j'avais une fourchette… Je mâchonnai et avalai la viande douceâtre… J'essuyai mes doigts avec l'herbe. Mes doigts sentaient (je les humai)… étrangement le poisson. L'herbe de septembre mêlée à la gelée (bicarbonates, chlorhydrates ? qu'y avait-il dedans ?) avait engendré une odeur de poisson… Central Park tressaillait de tous ses tréfonds, de ses taches sombres et claires, de toutes les nuances de vert, allant du vert tendre de la laitue au vert foncé des sapins, de toutes ses distances, de toutes ses formes géométriques ou, plus exactement, de toute son absence de formes. Un courant d'air soufflait doucement au ras de l'herbe dans mes jambes. Comme si on avait laissé les portes ouvertes. Un courant d'air comme dans un grand appartement mais celui-ci s'étalait du nord au sud sur une cinquantaine de rues et d'ouest en est sur une bonne dizaine. Un petit souffle glacé… Le souffle de la mort ?… Ce mec est un fou, évidemment. Pourquoi erre-t-il avec… un couteau démesuré pareil à un accessoire de théâtre ou à un couteau de cuisine ? Pourquoi l'exhibe-t-il au lieu de le cacher ? Les malfaiteurs noirs ou portoricains, par exemple, affectionnent les couteaux à lame fine éjectable de l'intérieur. Ou les couteaux à cran d'arrêt dont la lame est sortie par un ressort sur le côté. Les couteaux des Portoricains ressemblent aux Portoricains, ils sont aussi minces et agiles. Étant moi-même petit, aurais-je de la sympathie pour les Portoricains ? Peut-être… Ce type, c'est pas un Portoricain, il n'en a pas la silhouette. Un cinglé de Blanc dans la tête duquel tous les fils se sont mélangés. Ils se sont connectés au hasard, n'importe comment, ils se sont court-circuités et le voilà qui erre sans but à travers le parc plongé dans la nuit, Minotaure aux grands sabots tournant en rond. Certains fils de son cerveau se sont connectés à d'autres, au pôle opposé, voilà tout… Pourtant…
Un crissement se fit entendre derrière mon dos sur la butte. Quelqu'un avait marché sur une branche dans l'herbe, ou sur un sac vidé de… sur… Mon dos se décolla tout seul du tronc. Sans me redresser, toujours accroupi, j'effectuai une rapide volte-face du style pirouette comme le Prince dans « La Belle au Bois dormant », et je le vis. L'AUTRE se tenait à présent au-dessus de moi, toujours dans la même attitude — une main écartant la branche de pin de son visage, l'autre brandissant le couteau théâtral. Mes plantes de pieds se glacèrent, la sueur perla — je le sentis distinctement — sur mes mollets… Les mollets transpirent donc ? Je perçus cet étrange phénomène biologique comme l'ultime signal de mon organisme obsédé par sa propre conservation. Je me vis telle une machine près d'exploser : les aiguilles de tous les manomètres sont dans le rouge, tressaillent et oscillent. Il était urgent de sauver sa peau. Je me levai et, brandissant ma bouteille, émergeai de dessous le pin après avoir écarté la partie de sa frondaison qui gisait dans l'herbe. Je savais que si je me hâtais vers la sortie, vers la 72e rue (mon dos mesurait avec précision la pression de son regard), le type aux fils mélangés dans sa tête se jetterait sur moi parce que ses prunelles (ou toute autre partie de ses yeux qui lui servait d'enregistreur) percevrait la peur de mon dos. Un certain degré de chaleur, de peur, le « branche » et il se met à égorger, à grincer des dents, à découper le foie et à le dévorer, à découper le cœur et à le dévorer… Je me souvins bizarrement qu'on mangea le capitaine Cook quand on se rendit compte qu'il n'était pas Dieu. Et je me dis que la victime fatalement condamnée qu'on amenait dans la grotte du Minotaure devait être dans le même état que moi actuellement : seule, en tête à tête avec un cerveau méchant (étranger) au milieu de rochers, de pierres et d'arbres… L'idée de l'homme est porteuse de crime pour le lapin, la poule, l'agneau ou la vache. Pour eux, l'homme est l'Esprit Mauvais. Le Minotaure est porteur de crime pour l'homme…
En balançant doucement ma bouteille au bout de mon bras, je me dirigeai sans hâte vers le fond du parc. Là où il faisait encore plus sombre et où un enchevêtrement de sentiers goudronnés amenaient lentement le promeneur — après une distance égale à trente blocs de maisons — sur la Central Park South, la rue aux hôtels luxueux et aux longues limousines. Mon père m'avait suggéré, dès ma plus tendre enfance, qu'il ne fallait jamais fuir devant les chiens. Les types aux fils électriques mal connectés dans leur tête devaient se soumettre aux mêmes instincts qui régulaient la conduite des gros chiens. Les lois de la chasse.
Les premières minutes me coûtèrent. Lorsque son regard affaibli par la distance n'arriva plus directement à toucher mon dos, caché par les branches, les broussailles, les rochers, les angles des rochers (Central Park se trouve sur un plateau de basalte érodé aux temps antéhumains par un glacier rampant), je me sentis mieux. L'AUTRE ne se lança pas à ma poursuite car son logiciel — le But, le Gibier — obéissait à d'autres commandes. Le Gibier se démène nerveusement, crie, hurle, fuit. Mes bruits et mes mouvements n'avaient pas percuté sa gâchette. J'en suis persuadé. Je suis également certain que si je m'étais conduit autrement, si ma peur avait été captée par ses instruments, j'aurais fini gisant sous le fameux pin, les doigts dans la gelée de porc, les oiseaux picorant les restes de brioches, la bouteille de porto aurait roulé jusqu'au sentier goudronné, mon sang de qualité supérieure aurait imbibé la terre et agglutiné l'herbe en plaques comme le chocolat les cheveux d'un enfant…
Quand j'arrivai à la Central Park South, encore bruyante et éclatante de lumière dans la nuit, je sentis que j'allais vomir. Je m'appuyai contre la grille et éjaculai le porc toxique, le porto et les brioches irradiés par le regard de l'Esprit Malade…
*
Une théorie scientifique affirme que chaque chose n'est possible qu'à un moment strictement déterminé. Si on l'applique à mon histoire de Central Park, on en déduira que j'avais fait violemment irruption dans le temps nouveau avec un comportement appartenant au temps passé et cette incompatibilité avait failli me perdre. En 1977, lorsque je me promenais dans New York la nuit, j'irradiais un autre champ biologique, un champ puissant et dangereux. Or mon champ biologique d'aujourd'hui (celui d'un écrivain parisien), malgré tout mon courage et toute mon expérience, était à peine assez puissant pour repousser l'Esprit Malade. En 1977 le Minotaure n'aurait jamais osé m'approcher. Approcher un autre Minotaure.
Traduit par Elisabeth Mouravieff